Le comité scientifique qui a retenu le nom de Patrick Boucheron pour le prix Lyssenko avait l’embarras du choix. Cette distinction aurait pu aller aux auteurs du rapport du cabinet McKinsey selon lequel les migrants contribuent à près de 10% de la richesse mondiale ; à El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine, auteur de L’immigration en France, mythes et réalités ; ou encore à Jean-Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, qui s’est employé à démontrer dans un rapport récent que les discriminations pesaient sur la croissance économique. La grande faucheuse nous a privés d’une excellente candidate, Françoise Héritier, professeur au Collège de France, pasionaria du féminisme, pour qui la différence physique entre les hommes et les femmes “passe pour naturelle, alors qu’elle est culturellement acquise”[1].
Cela rappelle le cas de Jacques Derrida, qui nous a quittés en 2004 alors que nous nous apprêtions à lui attribuer le prix Lyssenko, élargissant ainsi le champ de ce prix à la philosophie, du moins à la philosophie sociale. Inventeur de la notion de déconstruction, Derrida peut être considéré comme un inspirateur de Patrick Boucheron, qui en applique le principe à l’histoire de France.
Pourtant, le choix de Patrick Boucheron s’imposait, tant cet historien, lui aussi professeur au Collège de France, a foulé aux pieds la déontologie de son métier d’historien et les principes de la méthode historique pour assouvir sa passion idéologique dans un domaine essentiel à l’idée que les Français se font d’eux-mêmes, de leur passé et de leur avenir : l’histoire de France. Il l’a fait dans un livre de 800 pages encensé par les media cosmopolites : Histoire mondiale de la France[2], qui a eu droit ainsi à trois pages entières dans Le Monde du 4 février 2017.

Ambition politique et parti pris idéologique
Boucheron expose d’emblée son “ambition” pour cet ouvrage : « Cette ambition est politique, dans la mesure où elle entend mobiliser une conception pluraliste de l’histoire contre l’étrécissement identitaire qui domine aujourd’hui le débat public. Par principe, elle refuse de céder aux crispations réactionnaires de l’objet “histoire de France” et de leur concéder le monopole des narrations entraînantes » (pp. 7-8). Il faut “dépayser l’émotion de l’appartenance et accueillir l’étrange familiarité du lointain” (p. 8). Le programme de Boucheron est donc limpide : il nous demande de dissoudre avec lui l’histoire de la patrie pour qu’il ne soit même plus nécessaire de renier celle-ci, devenue un fantôme. Feignant d’abord de se mettre sous le haut patronage de Jules Michelet, il condamne aussitôt ensuite son patriotisme : « Le patriotisme de Michelet nous apparaît aujourd’hui compromis par une histoire dont il n’était évidemment pas comptable, mais qui, après lui, s’est autorisée de cette “mission civilisatrice” de la France (…) pour justifier l’agression coloniale » (sic) (p. 9). Boucheron admettrait à la rigueur le prétendu “patriotisme constitutionnel” inventé par Habermas, honteux subterfuge qui dissimule le rejet de la patrie, à la condition expresse que celui-ci soit “le meilleur rempart contre la régression identitaire d’un nationalisme dangereusement étriqué” (pp. 9-10).
Boucheron ne cache donc nullement son parti pris idéologique, au contraire il le proclame. Il l’étale. Pourquoi se gênerait-il ? Il est la voix de l’idéologie dominante, celle du monde sans patries, sans frontières, et des soi-disant “citoyens du monde”, conçue en Grèce il y a 2.350 ans par Diogène le cynique. Cette idéologie cosmopolitique a traversé les siècles pour s’imposer enfin depuis une cinquantaine d’années et pour nous imposer le cosmopolitiquement correct (l’adjectif “cosmopolitique” est dérivé du substantif “cosmopolite”, du grec “cosmos”, le monde, et “politês”, le citoyen, et il traduit l’adjectif allemand weltbürgerlicher, qui signifie littéralement “du citoyen du monde”, employé par Emmanuel Kant en 1784[3]). Pour elle, l’immigration, l’étranger, le mélange, le métissage, la société ouverte, c’est bien ; la patrie, la nation, les traditions, les origines, l’identité, les frontières, c’est mal. Cette remarque élémentaire donne la clé de l’entreprise de Boucheron, qui n’est pas historique, malgré ses prétentions, mais idéologique et par conséquent, en vérité, anti-historique. L’histoire, quoi qu’on en dise, fait partie de la science. L’historien n’est digne de ce nom que s’il établit des faits avec objectivité, donc avec impartialité.
L’Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron est un gros livre de 800 pages constitué de 146 chapitres ou articles de deux ou trois pages, affectés chacun à une date et classés par ordre chronologique, de 34.000 avant Jésus-Christ (sur les hommes de Cro-Magnon de la grotte Chauvet) à 2015 après Jésus-Christ (sur les attentats de janvier et de novembre). Notre lauréat a recruté 121 collaborateurs pour cette entreprise. On notera avec amusement que deux d’entre eux ont reçu autrefois le prix Lyssenko : Jean-Paul Demoule, archéologue, “pour sa contribution aux études indo-européennes” (1993) et Alain de Libera, médiéviste, historien de la philosophie, “pour avoir mis en lumière les racines musulmanes de l’Europe chrétienne” (2007)… (Notons tout de même qu’une bonne partie des coauteurs du livre ont fait un travail honnête et ne méritent d’autre critique que d’avoir prêté leur nom à l’entreprise douteuse de Patrick Boucheron.)
Patrick Boucheron a prétendu écrire, avec ses collaborateurs, une “histoire mondiale de la France”. Bien malin celui qui peut donner un sens à cette expression, qu’il tente péniblement de définir, au début du livre, dans un charabia équivoque (p. 12). Il est vrai que, tout professeur au collège de France qu’il est, il confond “circonvolution” (enroulement autour d’un point central) et “circonlocution” (manière d’exprimer sa pensée par des détours prudents) (p. 8)… Toujours est-il que nous n’avons pas compris ce que signifiait une “histoire mondiale de la France”. Ce n’est pas l’histoire de l’influence du monde sur la France ou de l’influence de la France dans le monde, bien que certains des 146 chapitres relèvent de l’une ou de l’autre catégorie. C’est une histoire biaisée, maladroite, tronquée. Par exemple, lorsque l’on nous parle de l’intervention de Napoléon en Espagne, on arrive immédiatement aux conséquences qu’elle a eues dans les colonies espagnoles d’Amérique. C’est intéressant, nous n’en disconvenons pas, mais cette approche nous prive d’un exposé complet de la guerre d’Espagne. Le livre nous dit quand elle commence, mais non comment elle finit…
Patrick Boucheron a trouvé un titre clinquant, qui ne veut rien dire, mais qui fait illusion. Et qui fait vendre. Si l’Histoire mondiale de la France est un naufrage scientifique, c’est un beau succès commercial : plus de 100.000 exemplaires vendus.
Histoire en miettes
Boucheron et ses collaborateurs n’ont pas écrit une histoire de France, même mondiale, si l’adjectif a un sens. Ils ont écrit un récit ou plutôt une analyse incohérente émiettée en 146 chapitres. On ne pourrait même pas l’appeler “Histoire de la France en miettes”, parce qu’il y manque l’essentiel.
Premier exemple : la guerre de Cent ans, qui dura de 1337 à 1453. Six chapitres du livre, donc six dates, tombent dans ce laps de temps. Un seul se rapporte vraiment à ladite guerre : il y est question du traité de Troyes, 1420. Ni le chapitre consacré à la révolution parisienne de 1357 ni celui sur l’équipée espagnole de du Guesclin en 1369 ne concernent directement la guerre franco-anglaise. Les trois autres chapitres traitent de la peste noire (1347), de l’Atlas Catalan conservé à la Libraire du Louvre (1380), de l’esclavage dans le sud de la France (1446). Vous ne saurez donc rien pour ainsi dire de la guerre de Cent ans ; on mentionne une fois le nom des défaites de Crécy et de Poitiers, mais aucune des victoires, ni Patay ni Formigny ni Castillon. D’ailleurs, si vous n’étiez pas déjà au courant, vous ne sauriez même pas que finalement ce sont les Français qui ont gagné la guerre et les Anglais qui l’ont perdue…
Boucheron ne retient donc de la guerre de Cent ans que le traité de Troyes, celui que les Français ont toujours considéré comme une trahison dont s’est rendue coupable la reine Isabeau de Bavière, puisqu’il livrait la France à l’Angleterre. L’auteur, quant à lui, ne voit au contraire que des mérites au funeste traité. Ses raisons ne sont pas absolument claires : “Le traité de Troyes (…) marque à plus d’un titre le triomphe quasi performatif des représentations collectives par la percolation des croyances dans les actes les plus événementiels en apparence” (p. 231)…
Mais le funeste traité a pour lui le mérite d’en préfigurer un autre : celui de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 par Nicolas Sarkozy, digne successeur d’Isabeau de Bavière, traité qui a aliéné la souveraineté de la France à l’Union européenne. Libre à Boucheron d’avoir cette opinion détestable, c’est un jugement de valeur. Mais il n’est pas acceptable qu’il s’emploie à cette occasion à caricaturer les exploits de Jeanne d’Arc.
Deuxième exemple, l’action de Napoléon Bonaparte. On nous dit un mot de la campagne d’Egypte en 1798, sans nous expliquer clairement qu’elle s’est conclue par un fiasco, puisque l’armée française a été capturée par les Anglais en 1801. On nous parle du code civil, du sacre, des musées. Comme on l’a vu, on nous fait un récit partiel de la guerre d’Espagne. On tente aussi de dresser un bilan de l’aventure napoléonienne. Mais vous ne saurez rien du reste. Vous n’entendrez pas parler de la campagne de Russie ni de Trafalgar. Austerlitz n’apparaît pas et Waterloo n’est que citée.
Troisième exemple : l’Algérie. Des 132 ans de présence française, Boucheron ne retient que les déclarations de Napoléon III, affirmant en 1863 : “L’Algérie sera un royaume arabe” (p. 502).
Quatrième exemple, d’une nature différente. Le chapitre consacré à l’année 1919, intitulé “Deux conférences pour changer le monde”, met sur le même plan la réunion pompeusement dénommée “Congrès panafricain” qui s’est tenue à Paris pendant trois jours et la conférence internationale qui aboutit au traité de Versailles…
Vous avez dit : “Histoire mondiale de la France” ? Pourtant, on n’y verra rien sur la participation française à la Reconquista, alors qu’elle a été essentielle. Ni sur le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle : forcément, il s’agissait de saint Jacques “Matamore”, le tueur de Maures, c’est-à-dire des Arabo-Berbères musulmans.
On nous dit très peu sur les croisades. Encore moins sur les Barbaresques. On ne doit parler de l’islam qu’en bien.
L’islam a frappé à notre porte
Parmi les 146 dates qui ponctuent l’ouvrage, on s’attendrait évidemment à trouver 732 : la bataille de Poitiers où Charles Martel a arrêté les musulmans. Elle n’y est pas. A la place, Boucheron propose une date arbitraire, 719, suivie de ce joli titre : “L’Afrique frappe à la porte du pays des Francs” ! L’Afrique, c’est-à-dire l’islam, ne nous a pas envahis, elle a “frappé à notre porte”. Comprenez que nous avons été bien méchants et bien sots de ne pas la lui ouvrir.
En 719, nous sommes à Ruscino, près de Perpignan, où les archéologues ont découvert qu’il y avait eu une succession de conquérants, Wisigoths, Arabes, Francs… L’auteur nous invite donc à tous les mettre sur le même plan : un conquérant en vaut un autre, un Arabe vaut un Wisigoth. C’est même peut-être mieux, car l’harmonie était parfaite avec les Arabes, selon Boucheron et consorts : “Comme cela s’est passé partout en Al-Andalus (c’est-à-dire dans l’Espagne musulmane), une mère chrétienne enterrait son mari ou son fils musulman dans le cimetière de tous” (p. 94).
Double désinformation. D’abord, l’auteur devrait savoir que l’islam interdit d’enterrer ses fidèles à côté de mécréants. Ensuite et surtout, l’image idyllique de l’Espagne musulmane est une sottise absolue, dénoncée en dernier lieu par Philippe Conrad[4] et par Serafin Fanjul[5]. On se demande du reste pourquoi les chrétiens auraient consenti à tant d’efforts et tant de sacrifices pour reprendre l’Espagne aux musulmans s’ils avaient été si heureux sous leur joug.
Plus tard, et pendant des siècles, jusqu’à la conquête de l’Algérie en 1830, les côtes de la Méditerranée ont été ravagées par les Barbaresques, c’est-à-dire par les musulmans, Turcs, Arabes ou Berbères, qui ne se contentaient pas de prendre du butin, mais qui capturaient homme, femmes et enfants pour les vendre comme esclaves sur les marchés d’Alger au d’autres villes d’Afrique du nord. Cette “traite des blancs” perpétrée par les musulmans, dont on parle moins que de la traite des noirs à travers l’Atlantique, a enlevé plus d’un million d’Européens, dont des centaines de milliers de Français. On pourrait s’attendre, dans un livre d’histoire que l’on prétend mondiale, à ce que les exactions des Barbaresques et leurs terribles conséquences soient largement traitées. Mais il n’y a dans le livre qu’une allusion elliptique à ce sujet délicat qui ne va pas dans le sens du cosmopolitiquement correct.
Et, quand on nous invite à commémorer la belle victoire de l’équipe “black, blanc, beur” en 1998, on nous demande de ne pas nous laisser impressionner par les attentats terroristes qui ont eu lieu depuis. Ils sont, nous dit-on, les « fruits du djihad mené par de jeunes “musulmans” », et l’auteur prend soin de mettre le mot “musulmans” entre guillemets, laissant entendre que les terroristes ne le sont pas vraiment (p. 745)…
Neutraliser la question des origines
Ne comptez pas sur Boucheron pour mettre en évidence les racines chrétiennes de la France. Incroyable, mais vrai, il n’y a pas de chapitre sur le baptême de Clovis en 496. Cet événement fondamental marque pourtant le début du royaume des Francs, qui a servi de cadre à la formation de la nation française. Boucheron a tenté de justifier cette omission par l’incertitude sur la date, ce qui est un très mauvais prétexte[6].
A part un chapitre consacré aux apparitions de Lourdes (1858), qui détonne heureusement dans l’ensemble du livre, on n’y étudie pas la place essentielle que le christianisme a pris dans la formation du peuple français, c’est-à-dire à la fois dans sa constitution et dans son éducation.
Sur la question des origines, Boucheron atteint un négationnisme absurde. Chacun sait que la Gaule était peuplée de Gaulois, peuple celtique, et que ceux-ci furent successivement conquis par les Romains, puis par les Francs. Mais, pour Boucheron, il faut “neutraliser la question des origines” (p. 13). Et de façon aussi ridicule que péremptoire, il nous assène qu’il faut “reléguer au fantasme le vieux mythe des origines gauloises de la France” (p. 17). Et encore : “Le thème romantique des origines gauloises de la France nourrit depuis cent cinquante ans une fantasmagorie à valeur toute mythologique” (p. 51). Comment peut-on nier l’évidence à ce point ? Il est indubitable que la France est issue d’un synécisme celto-romano-germanique et que, numériquement, les conquérants romains et francs étaient très minoritaires.
Si Boucheron avait voulu écrire honnêtement et sérieusement l’histoire de France, il aurait dû nous conter les invasions gauloises du premier millénaire avant l’ère chrétienne, aux époques dites de Halsatt et de la Tène, et évoquer la thèse de Venceslas Kruta selon lequel des proto-Gaulois étaient déjà là 2.000 ans avant notre ère. Il aurait dû en outre souligner que Gaulois, Romains et Francs parlaient des langues apparentées et qu’ils appartenaient à trois branches de la famille indo-européenne.
Il aurait dû encore s’interroger sur l’identité qui résultait de ce synécisme et traiter de la société des trois ordres, oratores, bellatores, laboratores, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, qui était une expression de la tradition indo-européenne et plus précisément du modèle des trois fonctions ou idéologie tripartie, tradition et idéologie analysées par les grands savants français Georges Dumézil et Jean Haudry.
C’est une gageure de faire une histoire de France où il n’est pas question des trois ordres. Il n’est pas non plus traité dans le livre de la féodalité, si bien que l’on y perpétue la confusion entre le domaine royal et le royaume de France, par exemple quand on évoque le prétendu rattachement de la Bretagne à la France en 1491, alors que la province en avait toujours fait partie, puisque le duc rendait hommage au roi.
Chasser la race de notre histoire
Patrick Boucheron sait gré à Michelet, reprenant un mot de Lucien Febvre, d’avoir “chassé la race de notre histoire” (p. 10).
Peut-on se prétendre historien objectif si l’on entend “chasser la race de l’histoire” ? L’histoire est vécue par des hommes qui ont des ancêtres, un génotype, une race… Si l’on prend le mot race dans le sens strict de subdivision de l’espèce dans la taxinomie linnéenne, il n’est pas indifférent que la France soit, comme l’a souligné le général de Gaulle dans un passage qui devrait relever de l’évidence pour tout homme de bonne foi, un peuple de race blanche, ou, en termes scientifiques, de race caucasoïde.
Encore faut-il être de bonne foi. Alors qu’il ne veut pas entendre parler de la race du peuple français, Patrick Boucheron vante le génie d’Aimé Césaire et de Léopold Senghor, chantres de la négritude, c’est-à-dire de l’idée que les populations de race noire ou nègre (ou congoïde en termes scientifiques) participent d’une même civilisation. Boucheron chasse la race de notre histoire, mais non de celle des populations de race noire…
Boucheron ne se soumet pas au principe de contradiction. Pour lui, il n’y a pas de race (sauf la race noire…), et il s’enthousiasme pour Lucien Febvre (1878-1956) “décrivant le développement de la civilisation française comme l’essor fraternel de cultures métissées” dans un manuel publié post mortem en 2012 sous le titre “Nous sommes tous des sang-mêlé”. Pourtant, la logique élémentaire nous enseigne qu’il ne peut y avoir de métissage qu’entre deux individus de races différentes, donc qu’il n’y a pas de métissage possible s’il n’y a pas de races.
Tout en affirmant stupidement que l’espèce homo sapiens n’est pas divisée en races, les cosmopolites comme Boucheron font en permanence l’apologie du métissage. “Voilà ce qu’est l’homme de Cro-Magnon, notre ancêtre direct – un métis par vocation” (p. 21). “Le chemin parcouru par cet homo sapiens résolument moderne consacre la profondeur indicible de ses origines et le métissage irréductible de ses identités” (p. 19).
Avec l’homme de Cro-Magnon, on est encore en 34.000 avant Jésus-Christ. Mais le métissage conserve tous ses mérites 36.000 ans après, lors de la célébration en 1989 du bicentenaire de la révolution et de la parade de Jean-Paul Goude, qui annonce un “métissage planétaire” (p. 717). Alors, puisque Boucheron prétend aussi écrire l’histoire du temps présent (son livre va jusqu’en 2015…), il y a lieu de s’extasier sur la France “black, blanc, beur” qui a gagné la coupe du monde de balle au pied en 1998 grâce à l’immortel Zinédine Zidane, immigré maghrébin. “Si la victoire de 1998 a pu être lue comme celle d’un modèle social français, c’est que l’esprit fondateur de la nation française autour du vivre-ensemble, de la République et de la laïcité dans l’espace public, était toujours vivant” (p.748). Ce pathos cosmopolite n’a rien à voir avec la république authentique.
“L’époque est au métissage et à l’exaltation d’une France plurielle”, lit-on à l’avant-dernière page de l’ouvrage. Mais attention, “le discours hostile à l’immigration s’est renforcé” (p. 765) et l’on peut craindre “la lente érosion de l’idée d’une France ouverte et de toutes les couleurs” (p. 766) ! C’est le mot de la fin et il résume parfaitement le sens, l’intention et la portée de cette prétendue “Histoire mondiale de la France”.
Boucheron a beau se référer aux auteurs de l’école des Annales, il ne nous dit pratiquement rien des questions démographiques, économiques et sociales. C’est sans doute parce qu’il a voulu faire un ouvrage de combat politique et que ces considérations, au demeurant essentielles, ne lui étaient pas utiles. Au contraire même, s’il avait parlé de la population française, il aurait été obligé d’admettre qu’elle avait été d’une grande stabilité jusqu’au XIXe siècle. Nous l’avons dit, les conquérants romains et germains n’étaient pas très nombreux relativement. De plus, entre 550 et 1850, le territoire actuel de la France n’a quasiment pas connu d’immigration, à part les quelques milliers de Normands qui se sont installés sur l’embouchure de la Seine au Xe siècle. Et, s’il avait été honnête, Boucheron aurait dû avouer qu’après un siècle d’immigration européenne, de 1850 à 1950, la France connaît depuis un demi-siècle des vagues d’immigration venues du tiers monde et qui diffèrent du tout au tout des Français de souche par la religion, la culture et la race.
La France a connu jadis, il y a bien longtemps des mélanges de populations appartenant toutes à la race caucasoïde : il ne s’agissait donc pas de métissage au sens strict. Il en va différemment aujourd’hui. Or, comme l’a déclaré le général de Gaulle le 5 mars 1959 :
“C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.”[7]
Les grands hommes selon Boucheron
Boucheron prétend qu’il ne néglige pas les grands personnages (p. 12). Treize chapitres sur cent quarante-six sont consacrés spécifiquement à un personnage de l’histoire de France. Or, on ne trouve pas dans la liste Charles Martel, Guillaume le Conquérant, Saint Louis, Jeanne d’Arc, Louis XIV, Napoléon, de Gaulle, pour ce qui est de l’ordre politique. Ni Blaise Pascal, Jean Racine, Nicolas Poussin, Hector Berlioz, Claude Debussy. Ni André-Marie Ampère, Jean-Baptiste de Lamarck, Henri Poincaré… Jacques Coeur, Jacques Cartier, Jean Calvin et René Descartes ont droit à un chapitre, ce qui est légitime. Ces quatre hommes ont un point commun : le voyage ou l’exil. Et c’est apparemment ce qui conduit Boucheron à leur consacrer un chapitre, plutôt qu’aux grands noms que nous avons cités auparavant.
Cinquième personnage de la liste des treize : Rachi, le rabbin de Troyes, cité pour la date 1105 ; or, il avait sa place dans une histoire des Juifs plutôt que dans une histoire de France. L’auteur de l’article, Juliette Sibon, directrice de l’unité de recherche “Nouvelle Gallia judaica”, ne craint pas le ridicule en affirmant : “Rachi peut être considéré comme l’un des premiers grands auteurs français” (p. 138), alors que toute son œuvre est rédigée en hébreu et que les Juifs étaient à l’époque à l’écart de la société française, avant d’être expulsés en 1394.
Ensuite vient Marie Curie, qui a reçu le prix Nobel en 1903 avec son mari Pierre Curie et André Becquerel. C’est Pierre Curie qui a insisté pour que son épouse soit aussi récompensée, alors qu’elle n’était pas prévue à l’origine, parce qu’elle n’avait pas “seulement rempli le rôle de préparateur” (p. 555). Il est évident que Boucheron a choisi de parler de Marie Curie plutôt que des deux autres lauréats du Nobel parce que c’était une femme et surtout parce que c’était une immigrée polonaise. Il faut en effet ressasser indéfiniment que “l’immigration est une chance pour la France”, comme disait Bernard Stasi[8].
Puis, c’est André Malraux, cité pour 1933, date de publication de La Condition humaine, dont on nous fait comprendre qu’il a mal tourné ensuite, en devenant gaulliste.
Les sept autres personnages sont le marquis de Sade, Simone de Beauvoir, l’abbé Pierre, Frantz Fanon, Michel Foucault, Aimé Césaire. C’est une belle collection d’ennemis de la tradition, de la morale et tout simplement de la France. Patrick Boucheron a tenu à les mettre à l’honneur.
Boucheron ne dit rien de trois illustres étrangers qui ont pourtant joué un rôle éminent dans l’histoire de France : le Genevois Jean-Jacques Rousseau et les Savoyards saint François de Sales et Joseph de Maistre. Ce sont de grands écrivains et des penseurs de premier ordre. Mais de Sales était prêtre et de Maistre fut le théoricien de la contre-révolution. Quant à Rousseau, dont Robespierre était un fidèle disciple, Boucheron ne lui a sans doute pas pardonné d’avoir écrit :
“Forcé de combattre la nature ou les institutions sociales, il faut opter entre faire un homme ou un citoyen; car on ne peut faire à la fois l’un et l’autre.
“Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s’aliène de la grande. Tout patriote est dur aux étrangers ; ils ne sont qu’hommes, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L’essentiel est d’être bon aux gens avec qui l’on vit. Au dehors, le Spartiate était ambitieux, avare, inique : mais le désintéressement, l’équité, la concorde régnaient dans ses murs. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu’ils dédaignent de remplir autour d’eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d’aimer ses voisins.”[9]
Une terreur pas si terrible
Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau était le livre de chevet de Maximilien de Robespierre, l’organisateur de la terreur. La désinformation la plus scandaleuse, dans le livre, porte justement sur cette question ô combien douloureuse.
Le chapitre sur la terreur, daté de 1794, est intitulé “La terreur en Europe”. On y tente de justifier la terreur mise en œuvre par la Convention en affirmant mensongèrement qu’il en allait de même dans les autres Etats d’Europe. Autrement dit, la terreur n’était pas si terrible. L’auteur se garde cependant de faire des comparaisons chiffrées. Il avoue qu’en France, “en un an et demi, 35.000 à 45.000 individus sont exécutés pour crimes politiques” (pp. 417-418). Or, Hippolyte Taine nous a appris que la terreur avait commencé dans la rue dès 1789 et avant même le 14 juillet, quand les racailles de l’époque éviscéraient leurs victimes et portaient leurs têtes au bout d’une pique[10]. Si les nobles et les prêtres ont été si nombreux à émigrer, c’est pour ne pas avoir le même sort.
L’auteur ne nous parle que des malheureux qui ont été guillotinés, mais non de tous ceux qui ont été massacrés en masse par Carrier et les autres terroristes de la Convention. Pis encore, Boucheron ignore les guerres de Vendée et leurs cortèges d’atrocités. Il ne connaît pas Turreau, les colonnes infernales et le populicide vendéen. Omission infâme.
*
Résumons. L’ouvrage de Patrick Boucheron est affligé de trois défauts de méthode. Primo, le parti pris idéologique, qui justifie l’attribution du prix Lyssenko. Secundo, en corollaire du précédent, la mise en pièces de l’histoire. Tertio, l’anachronisme permanent qui invite à juger les événements du passé en fonction de l’actualité.
Patrick Boucheron n’a pas écrit une histoire de France. En 800 pages, il nous conte bien des anecdotes, sur la construction du Negresco ou le parfum n° 5 de Chanel. Certains de ses collaborateurs, que je ne voudrais pas assimiler à lui, nous donnent des textes intéressants sur des sujets particuliers. Mais, de même que Trophime Lyssenko avait prostitué la biologie, Patrick Boucheron a prostitué l’histoire. Il en a fait un instrument purement idéologique au service d’un projet politique. Il s’est attaché avec hargne à mettre l’histoire de France en miettes. Cet idéologue ne mérite pas le nom d’historien, mais il mérite le prix Lyssenko.
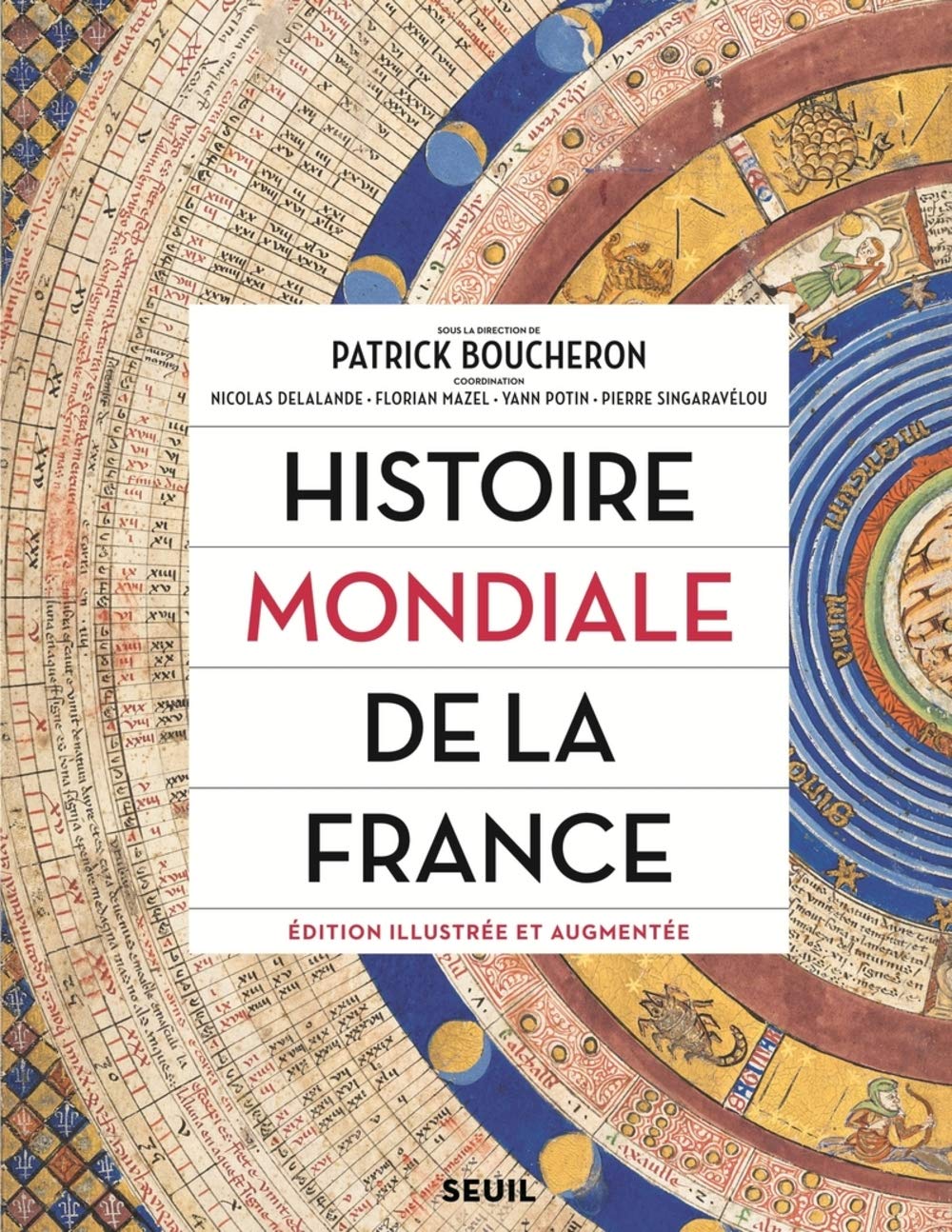
[1] Le Monde, 4 novembre 2017.
[2] Seuil, janvier 2017 (le livre, qui évoque des événements de 2015, a été achevé en 2016).
[3] Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique [Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht], 1784 ; Œuvres philosophiques, t. 2, traduction de Luc Ferry, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1985, pp. 185-205.
[4] Philippe Conrad, Histoire de la Reconquista, P.U.F., Que sais-je ?, 1998.
[5] Serafin Fanjul, Al-Andalus, l’invention d’un mythe, L’Artilleur, 2017. Voir aussi Darío Fernández-Morera, The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, ISI Books, Etats-Unis, 2015.
[6] Cité par Jérôme Gautheret, « En Italie, une “Histoire mondiale” sans histoires », Le Monde, 25 novembre 2017.
[7] Cité dans Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, t. 1, éditions de Fallois/Fayard, 1994, page 52.
[8] Bernard Stasi, L’immigration : une chance pour la France, Robert Laffont, 1984.
[9] Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l’éducation, in Œuvres complètes, t. IV, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1969, pp. 248-9 ; nous modernisons l’orthographe.
[10] Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2011.
